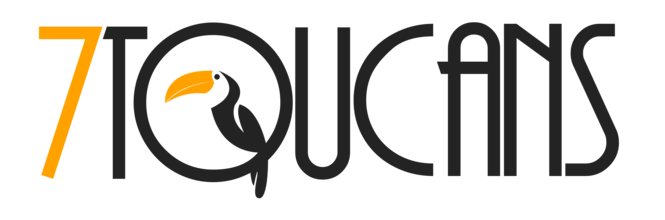Au milieu des eaux azur de la mer Adriatique chaude, au large des côtes du Monténégro pittoresque, il y a deux îles merveilleuses. Chacune d’elle est couronnée d’un temple charmant, mais contrairement à l’île artificiellement créée de Notre-Dame du Rocher, l’île de Saint-Georges est la création de la nature, et pas des êtres humains. La fabuleuse île est ornée des cèdres centenaires à feuilles persistantes – les symboles de la mort chez les anciens Romains et les symboles de la vie éternelle dans la religion chrétienne. Ces grands et minces arbres sont des compagnons permanents de tous les lieux saints érigés sur les étendues de l'Adriatique. Sur l’île monténégrine de Saint-Georges, ils abritent à l’ombre du soleil brûlant du sud les murs de l’ancien monastère bénédictin de Saint Georges.
Le monastère bénédictin a été mentionné pour la première fois dans les documents historiques comme propriété de la ville de Kotor au milieu du XIIe siècle. Cependant, selon les historiens et les archéologues, certains fragments du monastère ont à environ 12 siècles, ce qui signifie que le sanctuaire a été construit au IXe siècle.
Tout au long de son histoire, le monastère a subi de nombreuses attaques et destructions. D’abord les habitants de Perast ont tué l’abbé de Pascal, puis le pirate turc Karadoz a brûlé tout le monastère, puis Kotor a perdu son pouvoir sur l’île de Saint-Georges et ce dernier a passé aux mains de la République de Venise. Le tremblement de terre dévastateur du XVIIe siècle a également apporté des ajustements.
Les Français, les Autrichiens, ils ont tous voulu posséder cette île d’une beauté remarquable jusqu’à ce que les habitants de Perast reprennent leur île et reconstruisent l’ancienne abbaye bénédictine.
Sans aucun doute, il vaut la peine de visiter l’île voisine de Notre Dame, située à seulement 115 mètres de l’île de Saint-Georges, se rendre à l'ancienne église, admirer l’icône miraculeuse de la Sainte Vierge et les fresques originales du XVIIe siècle. Et n’oubliez pas de prendre une pierre avec vous pour la jeter et contribuer ainsi à la fortification de l’île, pour ne pas violer la coutume traditionnelle qui existe depuis des siècles.